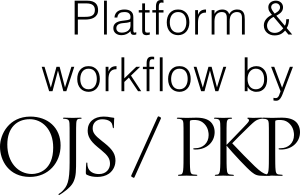Archives
-

Cahiers méthodologiques
Vol. 1 No. 1 (2023)Editorial - Michelle Bergadaà, IRAFPA, Genève (Suisse)
C’est avec fierté que nous inaugurons notre revue Les Cahiers méthodologiques de l’IRAFPA avec ce volume 1, numéro 1, dont le fil rouge est cette révolution qui depuis des mois, voire des années, nous préoccupe : l’intelligence artificielle.
L’Europe se prépare à légiférer sur l’IA. L’objectif est de mieux encadrer les outils tels que ChatGPT et d’en limiter les risques. L’IA fascine et inquiète, notamment dans le milieu de l’enseignement supérieur, car les étudiants comme les chercheurs ont de plus en plus recours à des outils d’intelligence artificielle. Nous ne savons déjà plus si les articles que nous révisons ou dont nous sommes coauteurs ont été écrits par un être humain ou par une IA.
L’intelligence artificielle bouleverse notre métier. Nous ne pourrons plus nous contenter de demander aux étudiants de rendre des mémoires de fin d’études ou aux chercheurs de produire des textes correspondant aux normes traditionnelles de la production scientifique. Nos habitudes, ancrées dans une pratique vieille de plus d’un siècle, sont désormais remises en question.
Nous avons retenu trois articles pour ce numéro, soumis au processus habituel des revues scientifiques d'appel à communications et de révision. Il s’agissait d’abord et avant tout de savoir ce qu’est notre identité de chercheurs : d’où venons-nous ? qui sommes-nous ? où allons-nous ?
Passé, présent, Futur. Ces auteurs sont issus des sciences de l’ingénieur, du droit, de la littérature et de la philosophie. Autant de regards croisés qui permettront au lecteur de poursuivre le débat, permettant ainsi aux sciences de l’intégrité de se renforcer et de se diffuser.
Bonne lecture à tous !
-

Cahiers méthodologiques
Vol. 2 No. 1 (2024)Editorial - Paulo Peixoto, Université de Coimbra (Portugal)
La question de l'intégrité académique et de ses implications éthiques, juridiques et stratégiques est au cœur des défis contemporains des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Ce numéro examine les transformations engendrées par les nouvelles technologies, la pression accrue sur les chercheurs et les rôles des divers acteurs dans la préservation de l'intégrité intellectuelle.
Ces enjeux prennent une dimension particulière dans un contexte marqué par l'accélération des mutations technologiques, notamment l'intelligence artificielle générative, qui bouleverse les pratiques académiques. Parallèlement, la course à la publication et la concurrence internationale amplifient les tensions sur les systèmes éducatifs, soulevant des questions sur la durabilité et l'équité des pratiques institutionnelles. Les scandales liés au plagiat, à la fraude académique et aux revues prédatrices renforcent la méfiance du public, mettant en péril la légitimité des institutions. Ce numéro propose une réflexion multidimensionnelle sur ces défis et des solutions pour promouvoir une culture d'intégrité académique.
Hervé Maisonneuve expose comment les pratiques mercantiles et les dérives éditoriales sapent la crédibilité de la recherche. Il met en lumière l'impact des revues prédatrices, qui exploitent les failles du système académique, attirant les chercheurs par des promesses de publication rapide, mais sans rigueur scientifique. Ces pratiques diluent les standards de qualité et aggravent la perte de confiance envers les institutions. Maisonneuve alerte également sur des phénomènes émergents tels que les « moulins à articles », qui industrialisent la production de faux travaux scientifiques. Son analyse plaide pour un renforcement des cadres éthiques et juridiques afin de préserver l'intégrité des savoirs.
Alexandre Zollinger s'intéresse aux répercussions de l'intelligence artificielle générative dans le monde académique. Il questionne la paternité des travaux réalisés avec ces outils et leur conformité aux principes éthiques. La prolifération d'outils comme ChatGPT redéfinit les frontières entre contributions humaines et automatiques, introduisant des risques de biais et de désinformation. Face à l'absence de réglementation claire, Zollinger propose une approche synergique entre éthique et droit pour garantir la transparence dans l'utilisation de ces technologies et préserver la qualité des productions scientifiques.
Ludovic Jeanne élargit la discussion en introduisant le concept de continuum « Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation » (ESRI), soulignant que l'intégrité académique dépasse les institutions éducatives pour inclure entreprises, ONG et décideurs publics. Il démontre que la fraude académique nuit à la légitimité sociale, à la confiance publique et au potentiel d'innovation. En illustrant les effets délétères de données falsifiées sur la prise de décision et les projets d'innovation, Jeanne appelle à une reconnaissance accrue de la responsabilité sociétale académique, essentielle pour garantir la fiabilité des décisions stratégiques dans un monde interconnecté.
Nicholas Jobidon examine les rôles des gardiens de l'intégrité académique : institutions, enseignants et étudiants. Il insiste sur une responsabilité partagée, appuyée par des politiques claires et une communication explicite des attentes. Il souligne la nécessité de soutenir les enseignants dans la gestion des cas de fraude et de sensibiliser les étudiants aux enjeux d'intégrité. En proposant une pédagogie proactive et collaborative, il esquisse les bases d'une culture d'intégrité durable.
Ce numéro offre des pistes pour renforcer la transparence, élément clé pour préserver la légitimité des institutions. Face aux défis posés par les technologies numériques et la mondialisation de la recherche, il appelle à des cadres éthiques et juridiques robustes, ainsi qu'à des pratiques innovantes. À travers ces contributions, il s'affirme comme un guide précieux pour accompagner les institutions dans la préservation des valeurs fondamentales de l'académie.
Bonne lecture à tous !
Lire l'éditorial complet : lien ci-dessous.
-

Cahiers méthodologiques
Vol. 1 No. 2 (2023)Editorial - Paulo Peixoto, Université de Coimbra (Portugal)
Lancés en 2023, les Cahiers méthodologiques de l'IRAFPA, débutent, avec ce numéro 2, la présentation des méthodologies qui nourrissent les initiatives de l’IRAFPA depuis 2016.
L'IRAFPA s'engage à harmoniser des méthodes éprouvées et des approches novatrices d'apprentissage. Leur solide cadre épistémologique et méthodologique a été consolidé et validé avec les participants des Écoles d’été dans des contextes d'expériences immersives. Il permet une mise en pratique concrète des méthodes acquises.
Partagées au sein des Écoles d’été, Colloques internationaux de l’IRAFPA et ouvrages en ligne ou édités, nos méthodologies et la manière dont nous les concevons et les consolidons, font de l'IRAFPA un mouvement scientifique agissant en faveur de l'intégrité académique.
Michelle Bergadaà et Marian Popescu montrent dans cet article comment les techniques théâtrales et la dramatisation constituent une méthode pédagogique appropriée pour que les individus et les institutions s'orientent vers la responsabilité sociétale académique.
Utilisé depuis six Écoles d’été de l'IRAFPA, le théâtre de situation, en tant que Méthode de recherche et d’action, permet aux participants de comprendre et développer des stratégies dans des contextes complexes de l'intégrité académique. La mise en scène basée sur des cas réels et jeux de rôles est particulièrement intéressante pour révéler des dilemmes éthiques.
Les prochains Cahiers de l’IRAFPA présenteront trois autres méthodes : la confrontation aux délinquants de la connaissance, les médiations IRAFPA et la certification « Institution responsable » et « Ecole doctorale responsable ».
Bonne lecture à tous !
-

Cahiers méthodologiques
Vol. 3 No. 1 (2025)“How to implement a culture of Integrity in Higher Education Institutions?”Editorial - Heidi Reed, Audencia (France) & Cinta Gallent-Torres, University of Valencia (Spain)
Academic integrity is recognized as a fundamental element of quality and trust in higher education. Recent research shows that promoting integrity is not only about preventing misconduct but about creating environments in which ethical behaviour is understood, supported and encouraged. To achieve this, institutions need coordinated actions that involve policies, teaching practices, assessment design and a shared understanding of roles and responsibilities across the institution, especially as the widespread use of digital tools and generative AI (GenAI) introduces new challenges, making it even more necessary for universities to implement strategies that promote responsible academic practices.
In this Vol. 3 N°1 , the most achieved communications of the 4th International Colloquium for Research and Action on Academic Integrity, hosted online by the University of Coimbra on 19-20 June 2025, offered an opportunity to reflect on how higher education institutions can implement and sustain cultures of integrity. The two-day programme brought together contributions on ethical academic promotion, sociocultural drivers of fraud, decolonial perspectives on integrity, behavioural interventions, students’ perceptions of responsibility, and the emerging challenges posed by AI. These discussions show both the urgency of the problem and the diverse strategies that universities can adopt to strengthen integrity as a core academic value.